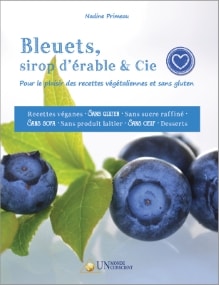Écrire a toujours été thérapeutique pour moi. Certaines fois, j’écris ce qui me passe par la tête pour le plaisir, d’autres fois pour me libérer… Mais, la plupart du temps, je laisse ces textes dormir dans mon ordinateur. Je ne fais rien avec. Sauf que ce texte-là, écrit il y a quelques années, il m’est revenu souvent en tête pour que je le sorte des vieux fichiers…
Honnêtement, je ne sais pas trop la raison pour laquelle je dois le publier. Est-ce pour le libérer complètement de moi ? Ou pour en faire sentir l’effet thérapeutique aux autres ? Je ne le sais pas trop. Mais je suis le dicton qui dit que le coeur en sait beaucoup plus que la raison…
Alors voici…
C’était l’hiver
Cet hiver-là, je me suis jurée pour une fois de m’écouter. Ça faisait des lunes que ma douleur intérieure était atroce. Elle me transperçait les sens, elle était tragique. Je ne pouvais plus la supporter ni l’entendre.
Il faut dire qu’avant ce temps, quand elle ne s’était pas montrée haut et fort, je ne m’étais pas encore permis de suivre le chemin qu’elle me montrait. Elle était en arrière-fond, cachée; bien malgré moi elle avait grandi. Et là, avec cette souffrance qui me tourmentait, qui gérait ma vie et qui me bouleversait sans cesse en criant dans mon intérieur, je n’avais pas d’autre choix que de l’écouter.
Définitivement, à l’entendre, je devais retourner pour une seule et dernière fois peut-être, dans ce lieu, vraisemblablement pour la faire taire ; ou était-ce pour l’écouter vraiment ? Avec ce qu’elle me criait si fort et la direction qu’elle me montrait, je devais sans doute remettre les pieds dans ce bois où j’avais grandi un temps et connu la joie de vivre, dans cette forêt où j’aurais tant voulu y vivre à tout jamais. Mais apparemment, ce n’est pas ce qui s’était produit, j’en avais été déracinée, arrachée à la terre. Un peu comme on coupe innocemment un sapin sur un terrain boisé.
Un jour de dépression, malgré les moins trente degrés, je me suis pointée chez l’oncle dans ce bois. Ma crise intérieure devait cesser. Lui-même, avec les sens plus trop en alerte, la bouteille à la main et le dentier défait, il m’a montré le chemin vers la vieille cabane. Bûcheron à ses heures, je me souviens, avec une odeur d’alcool pour me montrer la direction, il m’a lâché la bouche à moitié gelée :
– Tu vois là-bas dans l’fond, tourne à gauche pis suis le ch’nail, qu’il a gesticulé en se tournant le dos au vent avec sa bouteille pour pointer, toujours à la recherche d’une dernière gorgée.
– Oui, oui, merci, que j’ai répondu en baissant les yeux comme si je n’avais pas vu que la folie s’était emparé de lui, moi-même plus trop sûre de survivre à cette température ni à mon mal intérieur qui était comme une blessure à vif.
Par politesse, j’ai fait signe de la main à l’oncle pour indiquer que je partais ou plutôt que je me sauvais de lui. Devant cette route enneigée où personne depuis longtemps n’avait marché, j’ai renfoncé ma tuque pas assez chaude, j’ai caché ma bouche de mon foulard amaigri par le temps et j’ai avancé. J’allais où ? Vers quoi ? Au début, je ne le savais pas trop. J’imagine que, parce que cet homme me l’avait montré, c’était là, dans ce lieu sacré, que je devais me rendre. Sacré parce qu’au temps où il y avait eu une famille à cet endroit – j’avais été une des leurs –, il y avait aussi eu des gens heureux, des rires, de la vie, du sirop d’érable et un certain bonheur durable.
Mais devant ce froid raide, abrupt et intense comme sur le bord d’une falaise, à sentir éclater sur ma peau cette neige grésillante parsemée de ce vent de glace, j’aurais plutôt cru que je me dirigeais vers un endroit maudit. Maudit parce que dans les familles, il y a toujours ces histoires où il persiste des froids entre les gens comme un hiver qui s’immisce entre eux et qui n’en ressort plus. C’était bien là le malheur qui s’était produit pour tout ce beau monde de ma famille. Ces divergences et ces distances, comme des fissures dans la glace, avaient à elles seules fini par s’agrandir sous le poids du temps pour engloutir tous les bons souvenirs.
De toute façon, à affronter ce froid hivernal coupant, peu m’importait que cet endroit soit sacré ou maudit. Vraisemblablement, je devais me rendre quelque part au bout de ma douleur. Pour quelle raison ? Je ne le savais pas trop. Le seul point qui était tangible à marcher seule, péniblement, c’était cette détresse intérieure qui me servait de guide et c’est dans ce lieu qu’elle m’amenait. Et je savais aussi que c’était l’hiver. Un hiver intraitable, où la mort avait pris le dessus sur la vie et où la joie s’était éteinte comme un feu se meurt et laisse place à de la vieille cendre froide et poussiéreuse dans un poêle.
Mais par chance peut-être, en cette journée glacée, les dépouilles de cette vie, la mort et les cendres qui se trouvaient là dans mon cœur, me faisaient avancer pour me faire atterrir je ne sais trop où ou pour me faire vivre je ne sais trop quoi. Ne trouvant plus de raison de vivre, ce « plus rien » en moi, ce vide, avait au moins eu la gentillesse de m’amener à destination pour voir ce qui m’avait tué par en dedans.
Alors pour suivre la direction de cette douleur intense et pénible, j’ai marché un très long moment, titubant dans les bourrasques du vent, le jeans raide et gelé. J’ai eu le corps transpercé de froid, les doigts rougis ou bleutés, je ne sais plus. Parce qu’à ce temps-là j’étais rendue citadine, je ne savais plus trop interpréter avec précision les signes de l’hiver : à un point tel que je m’étais mal attriquée pour traverser en solitaire ce désert tout blanc. Le corps en tension, frigorifié, j’ai donc suivi des yeux ce point au loin qui m’a servi pour avancer dans cet enfer enneigé et pour ne pas perdre le nord dans une déroute.
Finalement, au bout de ma misère, le souffle haletant, dépareillée, je suis arrivée en avant de cette vieille maisonnée. C’était encore l’hiver. Mais je ne me suis pas effondrée comme on l’aurait vu à la télé. Ravivée par une force, au lieu, me plantant les deux pieds directement au sol bien écartés, la neige jusqu’au genou, je suis devenue invincible à l’hiver comme un arbre fier de se retrouver en terre. J’ai imaginé ma vie, les deux bras fortement lancés dans les airs, comme le chêne qui grandit, comme j’aurais tant voulu vivre quelque part ici ou autour, entourée d’arbres ou de cette grande famille.
Pour les quelques instants où j’ai respiré l’air pur dans cet élan, je n’ai plus eu froid, je n’ai plus senti le mal, la détresse ou ma douleur intérieure. J’ai vécu momentanément, j’ai fait partie de cette terre. Mais parce que je n’étais pas un arbre et que dans ce froid gelant je ne pouvais pas prendre racine, au travers de mes yeux, sans le vouloir, dans une sorte de transe et au ralenti, j’ai regardé ce vide devant et celui que j’avais par en dedans. Il y avait toujours là ces vieilles planches grises de bois et ce désert givré de neige qui avait habité cette vieille cabane, ma famille, et qui m’avait habité aussi par en dedans.
Et d’un coup, en revenant à l’hiver, forcée par un coup de vent, maintenant triste, j’ai baissé les bras. Et j’ai pleuré parce que je venais de comprendre mon mal intérieur criant de vérité. Dans ce lieu et dans cette cabane oubliée, il y avait eu des printemps à l’eau d’érable sucrée, des étés à cueillir les fruits dans les bois et des automnes à regarder la magie des feuilles tomber. Mais il y avait aussi eu un hiver, qui par malheur était arrivé brusquement et qui par sa force avait fait éteindre le feu sacré et la joie de vivre de cette famille. Cet hiver maudit, il n’avait pas que gelé nos racines ou fait engloutir tous nos souvenirs. Non. Parce qu’un jour de décembre, il y a des années déjà, cet hiver sacrant, il s’était immiscé dans la terre, comme un intrus qui s’infiltre dans le cœur de gens. De glace, par les veines, il avait réussi par en dedans, à se rendre dans le cœur même de cette famille, de cette maisonnée et de cette terre remplies d’arbres, pour tous les faire mourir.
Finalement, à avoir suivi la route de cette douleur qui m’avait assaillie, j’ai au moins compris que je portais aussi en moi le souvenir et la blessure d’une famille brisée par la glace et par le givre. J’étais moi-même une partie éclatée, brisée et esseulée, un peu comme une bûche d’un arbre coupé par un bûcheron alcoolique au cœur gelé qui portait en lui l’hiver comme un calvaire.